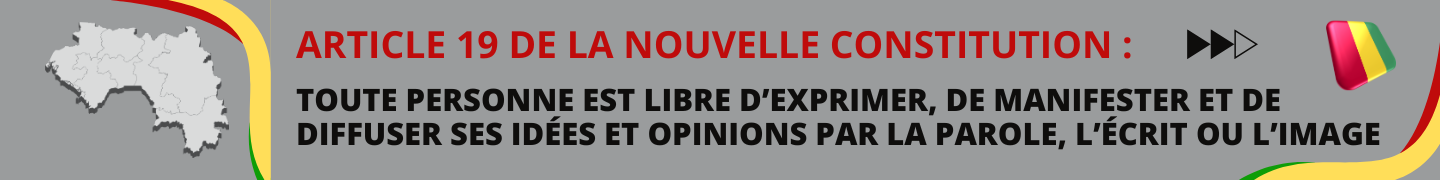« C’est moi ou personne, nous ne présentons pas d’autre candidat » ; « Il n’y aura pas de plan B, il n’y aura pas de plan C ! »
C’est par ces mots que Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA (ancien parti unique ivoirien, aujourd’hui dans l’opposition), a réagi à la décision de justice l’excluant de la liste électorale provisoire pour la présidentielle d’octobre prochain. Une décision sans recours possible, scellant de facto le sort de l’ex-patron du Crédit Suisse. Pourtant, l’intéressé persiste : il se présente comme l’unique candidat possible pour la plus ancienne formation politique du pays, quitte à boycotter le scrutin.
Un scénario familier sur le continent, que l’on croyait pourtant devenu obsolète après l’exemple sénégalais. Dans ce pays, Ousmane Sonko, leader du PASTEF et principal opposant à Macky Sall, a cédé sa place à Diomaye Faye, un responsable du parti, après l’invalidation de sa candidature.
Sans trancher sur la légitimité de la décision judiciaire ivoirienne ni spéculer sur les risques de résurgence des crises passées, le cas Thiam interroge : comment les partis d’opposition africains pratiquent-ils la démocratie en leur sein ? Moi ou le déluge ?
En Afrique, les partis d’opposition se parent volontiers de l’étendard démocratique face à des régimes qu’ils qualifient d’autoritaires. Pourtant, nombre d’entre eux reproduisent les travers qu’ils dénoncent : culte du chef, leader irremplaçable, dirigeants inamovibles, absence de relève. Une contradiction criante : comment promouvoir l’alternance sans incarner soi-même le renouveau ?
Le phénomène du « candidat naturel » illustre ce paradoxe. En Guinée, Alpha Condé – opposant historique devenu président – a fini par briguer un troisième mandat fortement décrié, alors qu’il existait au sein même de sa famille politique des alternatives crédibles, reproduisant ainsi les dérives qu’il critiquait naguère. En Côte d’Ivoire, estimant sans doute qu’il n’y a personne dans les rangs du RHDP digne de le remplacer à la tête de l’État, le président sortant Alassane Ouattara pourrait reproduire ce schéma en briguant allègrement son quatrième mandat. Selon son bon vouloir, comme il l’a toujours fait en tant que chef de parti.
Les opposants charismatiques justifient leur monopolisation du pouvoir par l’urgence de combattre avec efficacité « le système en place ». Résultat ? Des partis réduits à des fan clubs, où l’allégeance au chef, élevé au statut de « demi-dieu », prime sur le débat d’idées.
Plusieurs facteurs expliquent cette reproduction des schémas autoritaires : d’abord une culture politique marquée par le mythe de l’homme fort (une expression d’ailleurs courante dans le jargon médiatique). Ensuite, dans des contextes où le pouvoir se conquiert par la coercition, l’opposition adopte les codes du pouvoir afin d’exister. On invoque également la crainte des divisions internes. Face à un pouvoir répressif, les débats “intra-muros” houleux seraient susceptibles de rompre l’harmonie, créant des failles que pourrait exploiter le régime pour combattre l’opposition. Enfin, le nerf de la guerre étant l’argent, il y a le financement venant exclusivement des ressources personnelles du leader (généralement le fondateur) ou de soutiens externes, faisant des formations politiques une propriété privée.
Ce qui n’est pas sans conséquences : les faits montrent fréquemment qu’une opposition arrivée au pouvoir tend à reproduire ses propres démons. Le « messianisme » cultivé dans l’opposition ne garantit aucunement une gouvernance démocratique une fois parvenu au sommet de l’État.
In fine, les citoyens, désillusionnés par le pouvoir, se retrouvent sans alternative crédible. Les jeunes et les femmes, exclus des instances décisionnelles, se détournent de la politique. Tandis que, et c’est de bonne guerre, les régimes en place instrumentalisent ces dérives pour légitimer leur autoritarisme : « Vous voyez, les leaders de l’opposition aussi sont des dictateurs ! »
Comment sortir de l’impasse ? Outre le renforcement de l’éducation à la culture démocratique – puisqu’il ne saurait y avoir de démocratie sans démocrates –, les partis pourraient adopter des statuts limitant les mandats (comme le propose le PASTEF au Sénégal), à l’image de ce qu’on impose au président de la République. Des financements transparents (ajoutés à ceux, éventuels, de l’État) permettraient de rompre avec le modèle du « leader qui paie tout de sa poche ». Sans occulter, bien sûr, l’intégration des jeunes et des femmes aux postes stratégiques, au-delà du symbolisme.
Comme le rappelait Thomas Sankara : « On peut tuer un homme, mais pas ses idées. » L’idéal serait de bâtir des partis où les projets surpassent les individus, fussent-ils perçus comme des hommes providentiels. Sans cela, l’alternance ne sera qu’un changement de figurants, pas de système.
Top Sylla