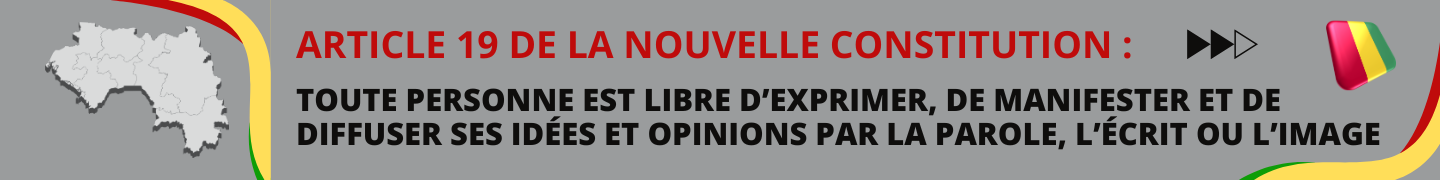Ce 3 mai, la Guinée célèbre, comme le reste du monde, la Journée mondiale de la liberté de la presse. Un symbole fort, mais qui sonne creux dans un pays où le « 4ᵉ pouvoir » vacille. Le classement annuel de Reporters sans frontières (RSF) en témoigne : une chute vertigineuse de 25 places, sanctionnant un climat délétère marqué par des retraits d’agréments, des suspensions arbitraires, des arrestations de journalistes, voire des disparitions inquiétantes, comme celle de Habib Marouane Camara, dont on est sans nouvelles depuis environ six longs mois.
Si cette journée invite à saluer les combats passés, elle doit aussi interroger les contradictions d’un paysage médiatique fracturé. Car les médias guinéens, autrefois fer de lance de la démocratie dans les années 1990-2000, peinent aujourd’hui à incarner leur rôle de sentinelle qui protège la démocratie en veillant à la transparence et en alertant la société sur ce qui pourrait menacer ses droits ou son équilibre. Hier, ils brisaient le monopole étatique sur l’information, défendaient le pluralisme et amplifiaient les voix marginalisées. Aujourd’hui, sous le poids des intimidations et d’une précarité chronique, leur lumière pâlit.
Derrière cette dégringolade se cache une réalité sombre. D’abord, la précarité structurelle : des rédactions sous-payées, des recettes publicitaires volatiles, et des charges économiques insurmontables. Dans cette lutte pour la survie, le sensationnel devient une stratégie de subsistance – un journalisme à moindre coût où dominent faits divers, polémiques politiciennes et rumeurs. Le débat d’idées, lui, s’efface. Peu de place est faite aux enquêtes approfondies sur l’éducation, la santé ou les politiques économiques.
À ces défis historiques s’ajoute un tsunami technologique : réseaux sociaux et intelligence artificielle (IA) bouleversent l’écosystème médiatique. Les fausses informations se propagent à grande échelle, alimentées par des deepfakes (contenus audio/vidéo falsifiés, très réalistes mais faux). Les rédactions, déjà affaiblies, manquent de ressources pour vérifier les faits ou contrer les manipulations. Pire, la fracture numérique marginalise davantage : outils d’IA inaccessibles pour beaucoup d’entre eux, langues locales ignorées par les algorithmes, et lois sur la cybersécurité détournées en outils d’intimidation et de censure.
Dans ce contexte, faut-il abandonner les médias aux lois impitoyables du marché ? Non, car l’information libre n’est pas une simple marchandise. Elle est ce que les économistes appellent un « bien public pur » : non exclusive (accessible à tous) et non rivale. Sa consommation par une personne n’en réduit pas la disponibilité pour les autres. Si vous écoutez une radio ou lisez un article en ligne, cela n’empêche pas d’autres personnes de faire de même. Contrairement à un sandwich ou un sac de riz (bien rival), l’information ne s’épuise pas quand on la partage.
Comme l’éducation ou la santé, elle mérite protection. Les radios communautaires, par exemple, diffusent gratuitement des contenus vitaux – un service public informel que l’État doit soutenir, via des exonérations fiscales, des fonds dédiés ou un cadre réglementaire équitable.
Mais l’État ne saurait porter seul ce combat à travers une subvention conséquente et autres formes de soutien. Aux médias de s’adapter résolument : privilégier les contenus responsables aux polémiques stériles, innover dans les financements en explorant des modèles hybrides (mécénats, abonnements ciblés, etc.) et renouer le dialogue avec le public. Quant aux citoyens, leur pouvoir est déterminant : en boycottant les contenus toxiques et en soutenant les médias rigoureux, ceux qui font preuve de professionnalisme, ils peuvent infléchir les pratiques malsaines.
« Sans une presse libre, éclairée et intègre, aucun gouvernement républicain ne peut survivre », rappelait Thomas Jefferson.
En ce jour symbolique, la Guinée doit se réapproprier cette vérité fondamentale. La liberté de la presse ne se résume pas à l’absence de censure : elle nécessite aussi des moyens pour garantir un journalisme responsable. Retrouver la fierté du métier n’est pas une affaire de nostalgie, mais une exigence : l’information doit redevenir un bien commun, et non un produit aux mains des puissants ou des intérêts particuliers.
Top Sylla