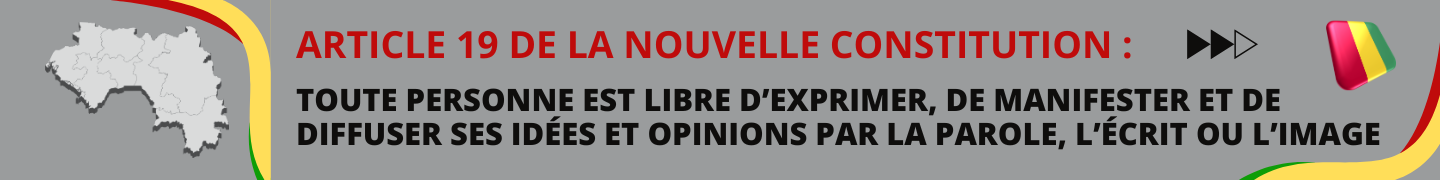Nous disons être revenus pour servir.
En réalité, beaucoup sont revenus pour briller.
Nous sommes de plus en plus nombreux à rentrer après quelques années passées en Occident. Sur les plateaux télé, dans les salons ministériels, dans les cercles d’influence ou sur les réseaux sociaux, le discours est bien rodé : « J’ai tout abandonné pour revenir servir mon pays. » Cette formule est devenue un talisman. Un passeport moral. Mais derrière ces mots nobles se cache souvent une réalité moins glorieuse : très peu ont réellement tout quitté. Nous avons changé de décor, pas de privilèges.
Là-bas, en Europe ou en Amérique du Nord, beaucoup menaient une vie ordinaire, parfois difficile. Des postes précaires, une existence discrète. Là-bas, ils étaient anonymes. Ici, ils deviennent dignitaires. Celui qui gérait les colis Amazon à Paris devient subitement directeur des investissements. Celui qui pédalait pour Uber Eats à Bruxelles atterrit au ministère des Transports. Celui qui n’a jamais managé autre chose que sa page LinkedIn prend la tête d’un département stratégique. Le chômage déguisé d’hier devient l’expertise revendiquée d’aujourd’hui.
Certains n’hésitent pas à enjoliver leur parcours. Ils inventent des diplômes, gonflent leur CV comme des ballons de baudruche. Leur seul diplôme authentique ? Une licence en flatterie appliquée, et un master en courbettes stratégiques. Ici, le vernis suffit. Peu importe la compétence, c’est l’apparence qui prime. Ce n’est pas le mérite qu’on valorise, mais la mise en scène.
Beaucoup pleurent leur « exil ». Mais posons les vraies questions : ont-ils fermé leurs comptes en euros ? Retiré leurs enfants des écoles privées à Montréal ou à Paris ? Ont-ils renoncé aux hôpitaux de Paris, Rabat ou de Dakar ? Non. Leur patriotisme a une clause de retour. Il dure le temps d’un mandat, d’un poste, d’un contrat.
Quand un Guinéen dit avoir « tout quitté à l’étranger » pour revenir, une question morale s’impose : était-il vraiment chez lui là-bas ? Ou était-il simplement un étranger parmi les étrangers ? S’il considère la Guinée comme sa patrie, pourquoi parler de retour comme d’un sacrifice ? Cette rhétorique trahit une relation instable à l’identité. C’est moins un retour vers le pays qu’une tentative de se réinventer là où les ambitions se heurtent moins à la concurrence.
En réalité, pour beaucoup, ce retour n’est pas un engagement. C’est une stratégie. Là où l’ascension est lente en Occident, elle est fulgurante ici dès lors qu’on maîtrise le discours lisse, les codes du réseautage et l’art de l’allégeance. Le storytelling du sacrifice devient une passerelle vers les honneurs. Derrière le slogan « revenir pour servir » se cache trop souvent un retour pour se servir.
Pendant ce temps, le peuple, lui, n’a pas fui. Il a enduré. Il n’a pas eu de visa, mais il a connu l’attente. Pas d’école pour ses enfants, pas d’eau potable, pas de soins de qualité. Il vit un exil intérieur. Son patriotisme ne monte sur aucun plateau. Il se traduit par le silence, la résilience, et la survie.
Nous, qui nous appelons technocrates, experts ou membres de la nouvelle élite, sommes trop souvent ceux qui verrouillent les portes de l’espoir. Nous construisons nos micro-règnes, bétonnons les opportunités, privatisons le pouvoir. Nous parlons d’État mais agissons comme si c’était notre entreprise privée. Nous servons… mais toujours depuis la business class.
Et quand on ose nous interroger, nous sortons l’arme émotionnelle : « Respectez mon choix, j’ai tout abandonné pour ce pays. » Mais si nous avons tant abandonné, où sont les résultats ? Où sont les routes viables ? Les écoles fonctionnelles ? Les hôpitaux dignes ? Nous accumulons les per diem, les décorations, les passeports. Le peuple, lui, attend.
Dans l’ombre, il y a une autre diaspora. Celle qui ne parle pas, ne parade pas. Elle travaille dur, envoie chaque mois de quoi nourrir, soigner, éduquer. Sans titres ronflants, sans photos, sans storytelling. Elle contribue réellement, mais ne cherche aucun trône. Elle n’a pas fui un échec, elle a choisi un effort. Son patriotisme est discret, mais solide.
L’État guinéen est devenu une zone de recyclage. On y transforme des échecs de là-bas en carrières miraculeuses ici. Le pays devient un laboratoire où l’on expérimente sur des citoyens sans protection, sans audit, sans droit de réponse. Ce n’est pas le développement qu’on vise, c’est la réparation personnelle d’un rêve raté ailleurs.
Il ne faut pas blâmer toute la diaspora. Il faut dénoncer l’imposture. La Guinée a besoin de ponts, pas de piédestaux. Elle a besoin d’acteurs ancrés, pas de touristes administratifs. Ceux qui rentrent doivent comprendre que servir, ce n’est pas survoler la douleur, c’est y plonger. Ce n’est pas jouer les héros, c’est devenir un des leurs.
La Guinée n’est pas un décor pour se refaire une santé morale. Ce n’est pas un tremplin pour égos frustrés. Elle a besoin de bâtisseurs, pas de décorateurs. De ceux qui vivent ici, tombent malades ici, luttent ici. Pas de ceux qui gardent un billet retour sous l’oreiller.
Pendant que certains paradent à Conakry avec leurs bouteilles d’eau minérale importée, le peuple boit une eau polluée, parfois cancérigène. Le vrai patriotisme ne se désaltère pas avec des produits importés. Il s’absorbe avec les souffrances du pays, il se vit avec la gorge sèche, sans filtre.
L’histoire ne retient pas ceux qui racontent. Elle retient ceux qui construisent. Thomas Sankara roulait en Renault 5. Nelson Mandela a quitté le pouvoir alors qu’il pouvait le garder. Ils n’avaient pas besoin de dire qu’ils avaient sacrifié leur confort : leur vie le prouvait.
Nous, les prétendus sacrifiés, achetons des 4×4, accumulons les indemnités et évitons le terrain. Ce que nous ne comprenons pas, c’est qu’on ne devient pas serviteur d’un peuple en prenant l’avion. On le devient en tenant dans la durée, en agissant dans le silence, en étant là quand il n’y a ni caméra ni fanfare.
La Guinée n’a pas besoin de héros costumés. Elle a besoin d’écoles debout, d’hôpitaux fonctionnels, de routes praticables, d’un État qui fonctionne. Pas de PowerPoints, pas de diplômes en vitrine, pas de storytelling creux.
La vraie diaspora ne rentre pas pour régner. Elle revient pour servir. Sans fanfare, sans paillettes, sans costume trois-pièces. Elle se lève, elle agit, elle s’efface.
Quand le théâtre se termine, que restera-t-il de notre amour pour ce pays ? Sommes-nous prêts à le prouver, sans mot, sans scène, sans récompense ?