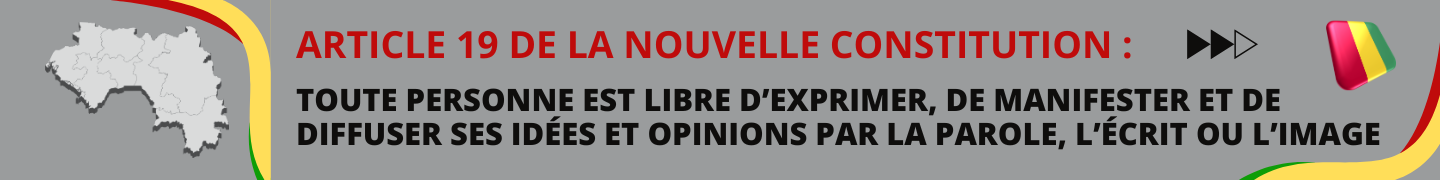Encore un renvoi. Ce jeudi 24 juillet 2025, la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a une fois de plus reporté l’audience en appel d’Ibrahima Kassory Fofana. Un, deux, trois, …cinq reports en cinq mois ! Et toujours la même justification silencieuse : attendre. Repousser. Gagner du temps. Mais pour qui ? Et pourquoi ?
Depuis sa condamnation, le 27 février dernier, à cinq ans de prison ferme et à la confiscation de ses avoirs, l’ancien Premier ministre est maintenu en détention dans des conditions sanitaires alarmantes, malgré plusieurs décisions de justice, y compris de la Cour de la CEDEAO, ordonnant sa remise en liberté. À croire qu’en Guinée, le droit a perdu sa force exécutoire, et la justice, son sens.
La décision de condamnation elle-même ne résiste pas à l’analyse. L’un des motifs invoqués ? L’absence du prévenu à l’audience. Mais depuis quand une absence pour cause médicale, documentée par des rapports officiels -y compris celui d’une contre-expertise ordonnée par la CRIEF- devient-elle une preuve de culpabilité ? Le droit guinéen n’en sort pas grandi.
Quant à l’accusation de détournement de fonds dans le dossier MAMRI, elle semble se heurter à une réalité comptable têtue : les 15 milliards supposément volés étaient soit encore disponibles sur le compte du projet à l’époque des faits, soit transférés légalement et justifiés. Faut-il vraiment s’en remettre à l’imaginaire pour combler l’absence de preuve ?
Et que dire de l’accusation de blanchiment ? Lorsqu’aucun lien n’est établi entre les fonds publics et les comptes personnels visés, la logique commande l’abandon des poursuites. Ici, la logique semble avoir déserté les prétoires.
Ce qui inquiète au-delà du cas Kassory, c’est l’image globale qu’offre la justice guinéenne dans ce dossier : une institution hésitante, engluée dans des considérations manifestement extérieures au droit, donnant l’impression d’un procès maintenu artificiellement à flot faute d’issue juridiquement acceptable. Une justice en apnée, suspendue à des impératifs qui ne disent pas leur nom.
Les renvois à répétition ne sont pas anodins. Ils traduisent un malaise, voire une gêne : comment rejuger un homme dont les droits fondamentaux semblent bafoués à chaque étape de la procédure ? Comment ignorer les décisions judiciaires -nationales et internationales- en toute impunité ? Et surtout, comment expliquer à l’opinion publique que la justice puisse, dans un État de droit, refuser d’appliquer ses propres décisions ?
Ce procès devient le symbole d’un bras de fer plus large : celui entre la légalité et l’arbitraire. Il met en lumière un appareil judiciaire à deux vitesses, où certaines décisions sont exécutoires sur-le-champ, tandis que d’autres restent lettre morte quand elles dérangent.
La justice guinéenne doit sortir de cette zone d’ombre. Il ne s’agit pas de défendre un homme, mais de défendre une institution. Le droit ne peut être un outil à géométrie variable, soumis aux vents politiques ou aux postures conjoncturelles. Il est la colonne vertébrale de la République. L’abandonner, c’est saper les fondations mêmes de la démocratie.
Ibrahima S. Traoré pour guinee7.com