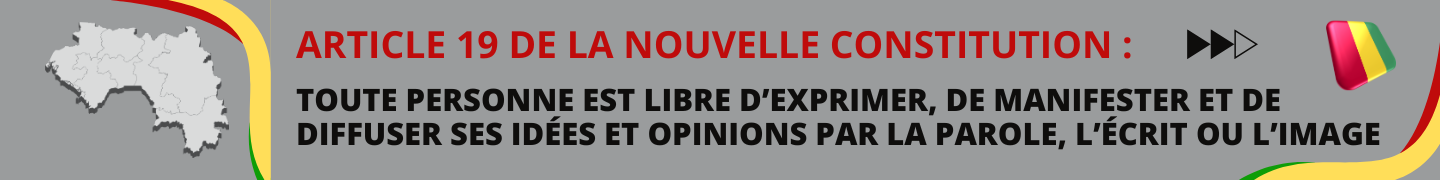Avant de se prononcer sur les dispositions du projet de nouvelle constitution, nous vous proposons d’abord d’examiner les anomalies graves et atypiques qui ont caractérisé l’ordre constitutionnel guinéen depuis 2010. Afin de vous situer pleinement dans le processus constitutionnel en cours et de comprendre les enjeux du nouveau projet de Constitution, à travers cette analyse juridique rigoureuse vous comprendrez les failles ayant miné la stabilité et la légitimité de nos institutions. Il s’agira d’étudier les conséquences juridiques et politiques de ces dysfonctionnements passés, dans l’espoir que le nouveau projet de Constitution, actuellement en phase de vulgarisation, puisse enfin clore un processus inachevé. Ce projet, dont l’élaboration a intégré un aspect consultatif, inédit et constant, vise à restaurer la confiance. Si ce processus, tel qu’il a été initié, parvient à son terme, il offrira à la Guinée l’opportunité de rompre avec les traditions de constitutions imposées et de fonder la Loi fondamentale sur une véritable volonté populaire.
Constitution de 2010 : une belle constitution illégitime
La Constitution de 2010 incarne la première de ces anomalies majeures et atypiques. Élaborée par un organe transitoire, le Conseil National de la Transition (CNT) à la suite des longs mouvements syndicaux et promulguée par décret présidentiel, un acte émanant d’un président de la transition issu d’un coup d’État militaire, ce texte manquait fondamentalement de légitimité et de légalité réelles. Malgré ces vices de forme et de fond, cette Constitution a pourtant régi la Guinée pendant une décennie.
Le vice fondamental de ce texte réside précisément dans l’absence d’un référendum populaire. Cette étape est pourtant indispensable, car elle consacre la souveraineté nationale et permet au peuple, détenteur initial et ultime du pouvoir constituant, de valider le contrat social de la République. Donc, priver le texte constitutionnel de ce plébiscite a eu pour conséquence de le réduire à un acte technique ou politique, déconnecté de la légitimité populaire. En droit constitutionnel comparé, il est unanimement reconnu qu’une Loi fondamentale adoptée sans référendum reste vulnérable à la contestation. La Constitution de 2010 s’est installée dans la durée sans jamais combler ce déficit de légitimité.
Elle fut ainsi, comme l’écrivait Georges Burdeau, une « légalité précaire », acceptée par défaut mais jamais pleinement vécue comme un choix partagé. Sur le plan politique, cette absence de légitimité populaire a créé un terrain fertile pour l’instabilité et la remise en question permanente de l’ordre institutionnel.
La décennie du reniement : manquement à la parole et crise de confiance
Cette fragilité originelle aurait pu être corrigée. Un engagement clair avait d’ailleurs été pris lors du dialogue politique qui a ouvert la voie à l’élection présidentielle sous cette Constitution. Le nouveau chef de l’État devait organiser sans délai le référendum constitutionnel. Cet engagement était une exigence du pacte social, engageant la bonne foi du président-élu envers le peuple de Guinée.
Le refus persistant d’Alpha Condé d’honorer cet engagement n’a pas seulement entaché dix années d’exercice du pouvoir d’une anomalie technique ; il a surtout alimenté une profonde défiance collective. Politiquement, ce manquement à la parole donnée a érodé la crédibilité des institutions et des dirigeants, rendant le régime vulnérable aux tensions sociales et aux ruptures.
Paradoxalement, les grands partis politiques d’opposition du pays à l’époque (UFDG, UFR, et PDEN), concentrés sur leurs petits calculs politiques, n’ont jamais considéré ce vice comme important, permettant ainsi à Alpha Condé de persister dans l’anomalie pendant dix ans.
La falsification de 2020 : de la crise de légitimité à la rupture du pacte républicain
La tentative de corriger le passé par le référendum de 2020 portait en elle une promesse de réhabilitation de l’ordre constitutionnel. Cependant, la procédure, entachée d’opacité et instrumentalisée à des fins de maintien personnel au pouvoir du président Alpha Condé, a débouché sur une situation encore plus grave, en l’occurrence, la modification clandestine du texte soumis et adopté lors du référendum. Cet acte, révélant une fraude institutionnelle inédite dans l’histoire constitutionnelle guinéenne, constitue une véritable forfaiture.
Juridiquement, nous sommes en présence d’un fait de haute trahison, un abus délibéré du pouvoir d’État pour altérer l’expression du suffrage populaire et substituer à la volonté de la nation celle du personnel politique.
En détournant la procédure et en publiant au Journal Officiel une version déformée du texte adopté par le peuple, le pouvoir a ainsi invalidé le pacte social. Un tel acte entraîne immédiatement l’inexistence juridique des modifications opérées, engage la responsabilité individuelle et collective des auteurs et, surtout, provoque une rupture irréversible entre les gouvernants et le corps civique. La Constitution cesse alors d’avoir une portée normative efficace ; elle n’est plus comprise ni respectée comme un contrat social. Ce qui aurait normalement dû avoir pour conséquence le rétablissement de la constitution immédiatement précédente, notamment celle de 2010, cella semble aujourd’hui la position de l’assemblée constituante actuelle (CNT ).
Cette forfaiture a été dénoncée par de nombreux juristes et personnalités de premier plan. Des juristes comme Jean Paul Kotembedouno (JPK) ont précisément recensé les dispositions qui ont été modifiées ou supprimées frauduleusement, n’hésitant pas à qualifier cela de falsification. Des personnalités comme Bah Oury, l’actuel Premier Ministre, ont été les premiers à signaler cette forfaiture. En tant qu’étudiants en droit à l’époque, nous avons été choqués et profondément déçus qu’un professeur de droit puisse commettre ou cautionner un tel acte.
Les conséquences politiques ont été dévastatrices, la défiance institutionnelle, la désobéissance civile organisée par les partis politique et la société civile et enfin, les évènements du 05 septembre 202. Car l’État s’étant lui-même rendu coupable du non-respect de la règle suprême.
L’espoir d’une refondation démocratique par une participation citoyenne inédite
Face à l’accumulation de ces anomalies, ce nouveau projet de constitution se justifie et se distingue précisément par l’intégration de cette leçon essentielle. En effet, toutes les étapes, du recueil des attentes populaires aux débats ouverts sur l’orientation fondamentale du régime, de la rédaction en comité pluraliste à la soumission au référendum du texte final, sont conçues pour multiplier les passerelles entre la Nation et le texte fondateur. Cela s’est traduit par des consultations initiales approfondies avec diverses composantes de la société civile y compris celle de la diaspora, des débats citoyens structurés, et une vaste campagne de vulgarisation à l’échelle nationale, utilisant des canaux variés (assemblées thématiques, émissions radio/TV, rencontres de proximité) pour informer et impliquer chaque citoyen, une véritable entreprise de co-construction civique. La Constitution issue de ce parcours sera sans doute le reflet d’un consensus vivant, d’une volonté collective assumée, et non le fruit projet imposé d’un compromis élitaire.
Si ce projet de Constitution parvient à son terme tel qu’il a été initié, il permettra à la Guinée d’achever enfin le processus constitutionnel inachevé depuis 2010. Le succès résidera dans l’appropriation citoyenne effective et réelle. Ce qui distinguera alors la future Loi fondamentale, ce n’est pas seulement sa qualité technique ou doctrinale, mais sa force d’adhésion, sa légitimité puisée à la source même de la souveraineté nationale.
Ainsi, nous auront une Constitution façonnée par tous, à la lumière des principes du droit comparé, des meilleures pratiques africaines et internationales, et sur la base d’un dialogue exigeant, qui inscrira notre pays dans la modernité démocratique, tout en refermant avec autorité et lucidité, les failles héritées d’un passé d’incertitudes et de manipulations.