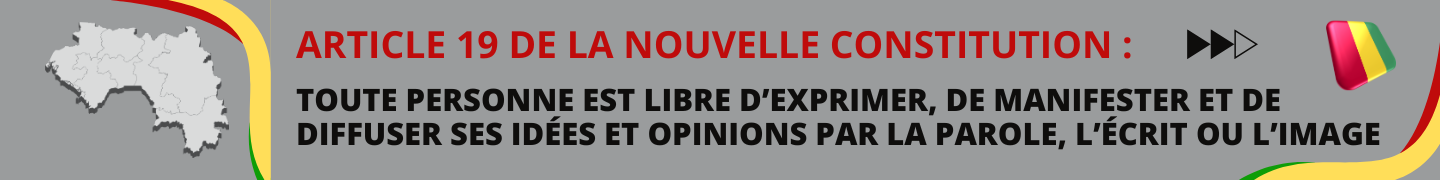Mardi 9 septembre 2025, un vent nouveau a soufflé sur le continent africain. Dans la région de Benishangul-Gumuz, à l’ouest de l’Éthiopie, le Grand Barrage de la Renaissance a été officiellement inauguré après quatorze années de lutte, de sueur, de sacrifices et d’espoir. Cet ouvrage n’est pas seulement un barrage. C’est une déclaration de souveraineté. Une démonstration que l’Afrique peut, seule, avec ses ressources, ses talents et sa foi, changer le cours de son histoire.
Le barrage a été financé sans un seul centime d’aide occidentale. Cinq milliards de dollars ont été réunis par l’État éthiopien, les citoyens et la diaspora, parfois au prix de lourds efforts économiques. Le résultat est gigantesque : une puissance installée de 5 150 mégawatts, soit le double de la capacité énergétique actuelle de l’Éthiopie. C’est le plus grand barrage d’Afrique, et l’un des plus puissants au monde. Il permettra à l’Éthiopie non seulement d’électrifier la totalité de son territoire, mais aussi de devenir un exportateur régional d’électricité, renforçant ainsi son influence dans la Corne de l’Afrique.
Ce projet a été porté par des mains éthiopiennes. Des milliers d’ouvriers, des ingénieurs, des soudeurs, des électriciens, des géologues, des conducteurs de machines, des architectes. La grande majorité sont des talents locaux, formés dans les universités d’Addis-Abeba, de Mekele ou de Bahir Dar. Certains, revenus de l’étranger après leurs études, ont décidé de contribuer à ce rêve national. Les plans ont été adaptés à la réalité du terrain. Les machines ont parfois été construites ou assemblées localement. Ce barrage n’a pas été « déposé » en Afrique par des entreprises étrangères : il a été conçu et bâti par des Africains pour l’Afrique.
L’ossature du barrage repose sur 1,8 kilomètre de béton armé, posé à la main et à la machine, couche après couche, dans une chaleur parfois étouffante. Pour résister à la pression de 74 milliards de mètres cubes d’eau, les ingénieurs ont utilisé un acier spécial, traité pour résister à la corrosion, à l’usure du temps, aux chocs thermiques. Une partie de cet acier a été produite sur le sol éthiopien, dans des usines modernisées pour l’occasion, une autre importée de partenaires stratégiques non occidentaux. Chaque pièce métallique, chaque vis, chaque soudure a été pensée pour durer des générations.
Le cœur du barrage, c’est sa centrale. Elle contient treize turbines géantes, installées dans des chambres creusées dans la roche. Leur mise en place a demandé une précision millimétrée, car une erreur aurait pu compromettre l’ensemble de la structure. Ces turbines transformeront la force du Nil Bleu en électricité, jour et nuit, pour des millions d’habitants. Et ce Nil, qui prend sa source à 85 % en Éthiopie, est au cœur des tensions régionales. L’Égypte dépend du fleuve à plus de 90 % pour survivre. Depuis des années, Le Caire exprime son inquiétude. Mais Addis-Abeba rappelle que ce projet ne vise pas à priver, mais à partager, dans le respect de la souveraineté éthiopienne. Désormais, l’eau du Nil ne coulera plus sans passer par les portes du barrage. L’équilibre régional en est transformé.
Ce chantier titanesque a aussi connu ses drames. Quarante-sept ouvriers sont tombés depuis le début des travaux. Certains sont morts dans des accidents mécaniques, d’autres à cause des conditions de travail extrêmes : glissements de terrain, chutes, fatigue, chaleur accablante. Leurs noms seront gravés sur une stèle à l’entrée du barrage. Ils n’auront pas vu l’inauguration, mais leur sacrifice fait partie intégrante de cette victoire. L’Éthiopie leur rend hommage avec respect, et leurs familles recevront des compensations promises par l’État. Ce barrage porte aussi leur mémoire.
Avec l’électricité produite, l’Éthiopie gagnera environ un milliard de dollars par an. Elle doublera son PIB énergétique dès la première année. Les villages isolés seront connectés, les usines tourneront à plein régime, les hôpitaux ne seront plus plongés dans le noir. De plus, le pays pourra vendre son électricité au Kenya, au Soudan, à Djibouti ou à l’Érythrée. Cela renforcera la paix et l’intégration régionale. À terme, l’Éthiopie ne sera plus seulement le pays des coureurs ou de l’histoire millénaire. Elle deviendra un hub énergétique, un modèle de développement autonome.
Ce projet n’a pas été parfait. Il y a eu des retards, des tensions diplomatiques, des sacrifices, des choix difficiles. Mais aujourd’hui, le monde regarde l’Éthiopie avec un respect nouveau. Ce barrage, c’est une réponse forte à ceux qui disaient que l’Afrique devait attendre l’aide, obéir aux institutions internationales, se soumettre aux ordres des puissances extérieures. Addis-Abeba a choisi une autre voie : celle de la liberté, de l’effort et de la dignité.
Le Grand Barrage de la Renaissance n’est pas seulement un mur de béton. C’est une colonne vertébrale pour le futur d’un peuple. Une flamme d’espoir pour tout le continent. Une preuve que, même face à l’adversité, même sans richesses naturelles énormes, un pays peut se lever et dire : « Nous l’avons fait. Par nous-mêmes. Pour nous-mêmes. »
Hommage au peuple éthiopien. Hommage aux bâtisseurs. Hommage aux disparus. Ce jour restera dans l’histoire comme celui où l’Afrique a, une fois de plus, montré qu’elle n’est pas un continent à sauver, mais un continent qui se relève. Fier. Libre. Debout.
Aboubacar SAKHO
Expert en Communication auprès du Haut-Commissariat de l’OMVS – Dakar