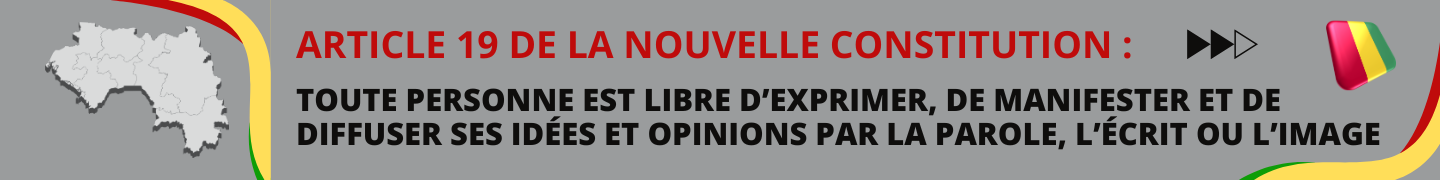Ils ont dansé, oui ! Ils ont dansé comme on danse au retour d’un miracle ou d’un marabout ressuscité. Toute la cour, la horde bien nourrie, ventres ronds et cravates bien serrées, s’est levée comme un seul homme pour chanter la louange d’une lettre et d’un signe. B+. Une note. Deux caractères. Et voilà tout un peuple convoqué à la fête du néant.
On aurait dit que le Bon Dieu avait enfin daigné signer un contrat avec la République. Le président en chef d’orchestre, les griots numériques en contrepoint, les journalistes apprivoisés en chœur – toute cette symphonie servie sur fond de misère crasse. Et pour quoi ? Pour un os. Un os léché, blanchi, qu’on jette à la foule avec un sourire de technocrate.
Car ce B+, malgré ses allures d’épiphanie, n’est ni plus ni moins qu’un cache-misère. Un klaxon diplomatique qui dit : vous ne tombez pas encore, mais on vous regarde. Un sursis, pas un sésame. Un verre d’eau tiède tendu à un mourant qu’on filme pour le journal de 20 heures.
Ils ont cru, eux, là-haut, qu’une note – une simple lettre de banque – suffisait à transformer la poussière en or, l’obscurité en lumière, les ventres vides en statistiques. On aurait dit qu’ils venaient de racheter la dette du Brésil, qu’ils allaient raser Conakry pour bâtir Manhattan. Mais la finance ne s’émeut pas : B+, c’est la cour des moyens faibles, des États sur le fil.
L’Argentine l’a eu, ce B+, avant la noyade. Le Liban l’a porté comme un costume trop grand, avant de sombrer dans l’abîme. Ces lettres-là, ce ne sont pas des décorations : ce sont des alertes. Des avertissements polis. Des mots glacés pour des lendemains incertains.
Mais ici, l’avertissement est devenu clairon. Ils ont soufflé dedans jusqu’à se convaincre qu’il sonnait victoire. Les tambours ont battu, les communiqués ont fleuri, les réseaux ont saturé. À la télévision nationale, on a mimé la liesse : ce théâtre d’ombres où la vérité passe sous le maquillage des bulletins officiels.
Et puis, au milieu de cette fanfare, voilà que surgit le miracle suprême : « La Guinée est désormais la deuxième puissance économique d’Afrique de l’Ouest ! » Quelle envolée ! Quelle magie ! Voilà que le rebasage d’un PIB de 50 % – simple pirouette statistique – devient un trône. Le Sénégal, la Côte d’Ivoire ? Relégués. Supplantés. Par qui ? Par nous, les crève-la-faim à qui l’on vend l’air pour du mil.
Mais cette médaille de bronze en toc, qui la portera quand l’enfant de Fougoumba ira chercher son eau à cinq kilomètres ? Qui s’en servira quand les coupures d’électricité feront encore danser les ombres sur les murs nus ? Deuxième puissance, disent-ils. Mais dans quel classement ? Celui de la comédie ou celui de la survie ?
Et l’on me dira, comme une ultime incantation : « C’est la première fois que la Guinée est notée ! C’est historique ! » Oui, c’est une première. Une première gifle. Une première convocation dans le bureau du monde. Pas pour nous féliciter, non. Mais pour nous surveiller. Pour prendre enfin acte de notre existence, comme on prend note d’un malade en salle d’attente.
Regardez le Ghana, le Sénégal : ils ont reçu leurs B+, et les ont traduits en routes, en machines, en projets. Ils ont su écrire leurs lettres sur le sol. Nous, on les grave sur les murs en carton-pâte de la télévision nationale. On confond les bulletins avec les repas.
Kémoko Touré, ancien directeur général de la Compagnie des Bauxites de Guinée, homme intègre au verbe lucide, avait vu juste. Il répétait que, chez nous, la cérémonie de remise des diplômes coûte souvent plus cher que l’école elle-même. Que l’on s’extasie devant l’emballage pendant que la boîte est vide. Que l’on célèbre l’arrosoir pendant que les champs se dessèchent.
Mais qui écoute encore ceux qui parlent de gangrène ? Qui prête l’oreille aux voix sages, quand les tambours couvrent tout ? Ici, la pensée magique a pris le pas sur le plan. L’optimisme béat est devenu la seule vertu patriotique. La critique ? Hérésie.
Ce texte n’est pas un pamphlet. C’est un cri d’estomac, un gémissement de ceux qui vivent loin des studios, hors-champ, là où les chiffres ne remplissent pas les marmites. Car un B+, aussi prestigieux qu’il puisse paraître dans les colonnes de Jeune Afrique, ne construit pas d’école. Il ne répare pas un hôpital. Il ne guérit ni la honte ni la faim.
Alors, dites-moi : ce B+, on le mange comment ? Faut-il le piler avec les slogans ? Le servir en ragoût de chiffres ? Faut-il l’imprimer sur les sachets d’eau ou le scander aux enterrements ? Combien de B+ encore, avant qu’un enfant ne voie une ampoule s’allumer au bout du fil ?
La vraie question est là, nue, brute : ce pays a-t-il encore le luxe de fêter ce qu’il ne comprend pas, de s’extasier sur ce qu’il ne maîtrise pas ?
Un jour peut-être, ce B+ signifiera des routes lisses, des écoles debout, des ventres pleins. Mais en attendant, le peuple danse.
Danse sur le vide.