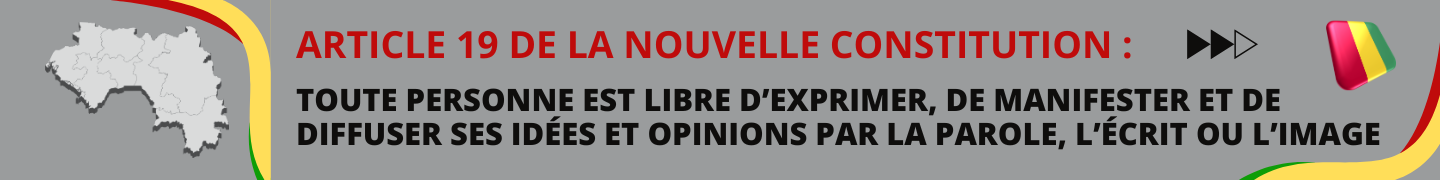En Guinée, la vie politique et publique est largement dominée par une passion ethnique excessive et l’absence de vrais débats constructifs à même de permettre aux populations d’opérer des choix éclairés. C’est tout le contraire de ce que devrait être une vie politique et publique apaisée dans une démocratie plurielle, ouverte et tolérante.
Les personnes sont rarement jugées pour les actes qu’elles posent mais plutôt pour ce qu’elles sont, indépendamment de leur vouloir. Or personne n’a choisi son nom, son village, bref son identité. On est dans ce pays, angélique ou diabolique selon la communauté à laquelle on appartient. Bienvenu dans le monde des clichés et des préjugés dans un monde aux mœurs politiques rétrogrades !
Aujourd’hui, la vie politique en Guinée est dominée par deux grands partis tentaculaires à forte coloration ethnique et régionale. Ces deux majors, aux forces centripètes, sont à la base d’un important malaise social qui déteint sur la vie publique et quotidienne. Alors qu’ils ont des partisans conquis d’avance, sans effort de persuasion, ces partis mettent en place des stratégies d’embarquement du reste de la population dans des conflits, situés à des années-lumière de ses intérêts.
Poids du facteur ethnique dans la vie politique et publique en Guinée
En Guinée, il est fréquent que les ethnies s’accusent mutuellement d’ethnocentrisme. Pourtant, en jetant un regard sur leur passé, il est frappant de se rendre compte que dans leur quintessence, elles sont généreuses, ouvertes, et hospitalières. Mieux, la nation guinéenne telle qu’elle existe aujourd’hui, est le fruit d’un important brassage entre les communautés. Ce mélange vient de diverses formes d’alliances sociales.
Il est donc faux de croire ou de faire croire qu’en Guinée, une ethnie porte en elle-même les germes d’un ethnocentrisme qu’elle transmettrait de génération en génération. Ces propos stigmatisent, mettent à mal le tissu social du pays façonné par le travail acharné de nos ancêtres qui avaient un sens élevé du respect de soi et de l’autre.
L’ethnocentrisme dans la vie politique et publique est d’apparition très récente. Il est né à travers les différents régimes qui se sont succédé à la tête de l’Etat. Il est secrété par ces régimes dans l’unique but de permettre à celui qui l’incarne de conserver aussi longtemps que possible, généralement tout au long de sa vie, le pouvoir suprême.
Le pouvoir étatique est encore considéré en Guinée comme la voie royale d’accès aux ressources de la nation, à l’affirmation de soi, à l’amélioration du sort d’une communauté et à d’autres privilèges.
Les privilèges réels ou imaginaires dans certains cas qu’une large majorité des membres d’une communauté tire du pouvoir étatique incarné par un de ses fils, sont si forts que l’idée de perdre ce pouvoir, même à travers une élection démocratique, leur paraît ridicule et surtout surréaliste.
C’est ici que la compétition politique autour du pouvoir vire à la confrontation entre les communautés dont sont issus les leaders politiques. La perception du pouvoir sur cet angle est naturellement source de tensions, de frustration et de repli sur soi des communautés marginalisées dans l’exercice du pouvoir.
Un Etat repensé, remède contre l’ethnocentrisme
C’est à l’Etat que revient en tout premier lieu la responsabilité de lutter contre l’ethnocentrisme. Ceci exige le retour de l’Etat aux principes fondateurs de la République. Il s’agit de l’égalité, la fraternité et la justice.
Le retour à ces fondamentaux exige à ce que le chef de l’exécutif soit doté des qualités d’un véritable homme d’Etat. Un personnage qui inspire confiance à la grande majorité et qui n’est pas dans le contexte particulier de la Guinée, prisonnier de sa communauté.
Il doit nettement se démarquer des personnages politiques aveuglés uniquement par leur élection ou réélection et surtout prompts à faire plier l’Etat, sa constitution et ses principes à leurs désirs personnels, y compris celui de demeurer à vie à la tête de l’Etat sans égard à la place qu’ils occuperont dans l’histoire de la nation. Bref, il doit avoir le sens de l’histoire et travailler à la construction d’un Etat dont la légitimité est acceptée de tous.