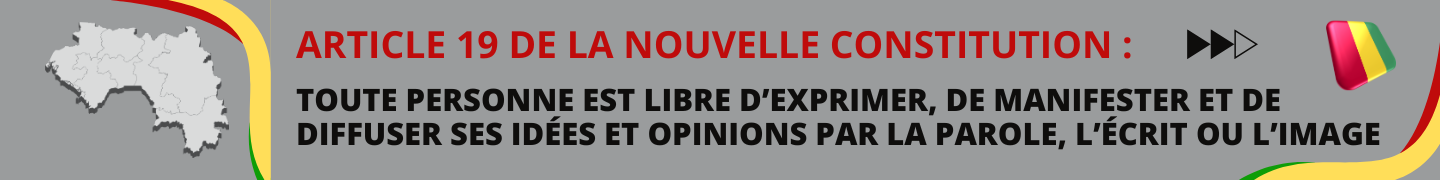La décision de l’État guinéen de mettre un terme à la convention minière liant le pays à Guinea Alumina Corporation (GAC) n’a rien d’un geste impulsif. Elle s’inscrit au contraire dans le prolongement d’un processus long et rigoureux, négociations répétées, rappels à l’ordre successifs, mise en demeure officielle autant d’étapes infructueuses face à un manquement majeur, notamment le refus constant de construire la raffinerie d’alumine pourtant prévue par la convention.
Face à cette rupture, GAC agite désormais la menace d’un recours à l’arbitrage international. Mais la Guinée, sûre de ses droits et forte de la légitimité de sa démarche, affiche une position résolue, calme et juridiquement assurée.
Cet article cherchera à démontrer le bien-fondé juridique de cette décision de l’État guinéen, à analyser le processus d’arbitrage international devant le CIRDI, comme envisagé par GAC, et à mettre en lumière les limites objectives de cette voie pour l’entreprise.
Il soulignera également en quoi cette décision s’inscrit pleinement dans le cadre de la doctrine du Quasi-Monopole Naturel (QMN).
Une décision juridiquement solide et stratégiquement nécessaire
Cette décision de résiliation repose sur une base juridique solide, constante et difficilement contestable. Dès la signature de la convention de base, le 15 octobre 2004, GLOBAL ALUMINA (devenue GAC) s’est engagée, à l’article 6, à construire une raffinerie d’alumine en Guinée, dans un calendrier défini. C’était une obligation centrale du contrat, liée à l’article 5, qui réservait à l’entreprise le droit exclusif de construire des installations industrielles. En clair, ce droit n’avait de sens que s’il s’accompagnait de la création effective d’une industrie locale.
Cette exigence a été précisée dans l’Annexe 3 de la convention, qui détaille les infrastructures attendues, notamment la raffinerie, une zone industrielle, un port minéralier, et un ensemble logistique structuré. L’ensemble forme un tout cohérent, qui montre que l’objectif n’était pas seulement d’extraire de la bauxite, mais bien de transformer une partie de cette ressource sur place.
Contrairement à ce que certains pourraient penser, cette obligation n’a jamais été abandonnée. Au contraire, l’Avenant n°2, signé en novembre 2013 à Abu Dhabi, a réaffirmé noir sur blanc l’engagement de GAC à construire et exploiter une raffinerie à Sangarédi. Il n’existe donc aucune ambiguïté juridique. L’entreprise savait ce qu’elle devait faire, et elle a reconnu elle-même cet engagement à plusieurs reprises.
Et pourtant, près de vingt ans après la signature de l’accord, la raffinerie n’a jamais vu le jour. Ce retard ou plutôt cette inaction constitue un manquement grave à une obligation essentielle du contrat. En droit des contrats, l’inexécution d’une clause aussi importante ouvre la voie à une résiliation légitime, surtout lorsqu’elle déséquilibre profondément le partenariat initial.
Il faut aussi rappeler que l’État guinéen n’a pas agi dans la précipitation. Plusieurs années de dialogue, de rappels à l’ordre, de discussions techniques ont précédé la rupture. Malgré tout, GAC a continué à éviter le sujet, préférant mettre en avant ses efforts en matière de transport ou d’infrastructures logistiques, sans jamais avancer concrètement sur la raffinerie. Ce choix stratégique, assumé, s’est accompagné d’une communication habile, mais vide d’engagements réels.
C’est donc après une mise en demeure formelle, restée sans suite, que l’État a décidé de mettre fin au contrat. Une décision radicale, mais juridiquement justifiée, et rendue inévitable par l’inaction prolongée de son partenaire.
Un tournant historique : la Guinée reprend la main sur sa politique minière
Cette rupture est le signe d’un changement de paradigme majeur dans la politique minière guinéenne. Désormais, l’accès aux ressources guinéennes est réellement conditionné à leur valorisation locale. Le message envoyé aux investisseurs est clair, il consiste de les dire que les engagements contractuels relatifs aux infrastructures de transformation locale doivent être pleinement respectés.
Ce message va au-delà du cas GAC, qui ne représente en réalité que 10 à 15 % de la production nationale de bauxite. Il s’adresse surtout aux géants historiques du secteur, tels que la Société Minière de Boké (SMB), qui assure environ 31 % de la production, et la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), autour de 20 %.
Il s’agit de briser le modèle extractiviste qui ne laissait que des miettes et de la pollution (la boue et poussière rouge) pour la Guinée, pour orienter les projets miniers vers la création d’emplois qualifiés, le transfert de technologies, et une répartition plus équitable de la richesse produite.
Dans ce nouveau scénario, Emirates Global Aluminium (EGA), la maison-mère de GAC, a bien plus à perdre que la Guinée. Sa chaîne de valeur dépend de manière cruciale, voire exclusive, de la bauxite guinéenne. Il est estimé que plus de 52 000 emplois directs et indirects, aux Émirats arabes unis et ailleurs, sont directement liés à cette ressource. Une rupture prolongée avec la Guinée compromettrait sérieusement la stabilité industrielle et la pérennité d’EGA.
Certes, il serait irréaliste de nier les effets collatéraux à court terme, notamment pour les travailleurs guinéens directement ou indirectement employés par GAC. Ces préoccupations sont légitimes et doivent être prises en compte. Cependant, elles ne sauraient faire obstacle à une réforme de fond indispensable. L’État guinéen ambitionne de bâtir un modèle industriel intégré, où les emplois ne se limiteront plus à la simple extraction, mais s’étendront aux filières de transformation, de logistique et de services, permettant de créer des milliers d’emplois qualifiés, durables et mieux rémunérés, tout en générant des recettes fiscales accrues pour le pays. C’est une recomposition stratégique audacieuse, résolument tournée vers le développement humain et territorial de la Guinée.
L’arbitrage international : un chemin complexe, coûteux et risqué pour GAC
Si GAC persiste dans son intention de porter le différend devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), elle devra d’abord se conformer aux étapes préalables imposées par les traités et les clauses d’arbitrage. Cela implique, en premier lieu, l’envoi d’une notification officielle à l’État guinéen, déclenchant une phase de négociation amiable (appelée cooling-off period), d’une durée généralement comprise entre trois et six mois.
Durant cette période, chaque partie est tenue de démontrer sa bonne foi. Il ne s’agira pas pour GAC de gagner du temps ou d’enrober sa position dans un discours diplomatique, mais de proposer des solutions concrètes et crédibles. De son côté, la Guinée pourra se montrer ouverte au dialogue, sans pour autant céder sur l’essentiel, notamment, la nécessité d’un engagement industriel ferme, visible et traçable.
Si cette tentative de règlement amiable échoue, alors l’arbitrage proprement dit s’engagera. À ce stade, la charge de la preuve incombera à GAC, qui devra démontrer que l’État guinéen a agi de manière abusive, arbitraire ou discriminatoire. Une telle démonstration s’annonce particulièrement difficile, tant la résiliation repose sur des obligations contractuelles claires, maintes fois réaffirmées, et restées sans suite du côté de l’investisseur. En l’absence d’éléments tangibles indiquant une violation manifeste du droit international, la position de la Guinée reste non seulement défendable, mais juridiquement solide.
Par ailleurs, la procédure arbitrale est connue pour sa complexité, sa durée (souvent deux à quatre ans) et ses coûts considérables, pouvant s’élever à plusieurs millions de dollars. Le tout sans aucune garantie de succès pour GAC ou sa maison-mère EGA. Face à cela, la posture guinéenne apparaît à la fois rigoureuse sur le plan du droit et pleinement légitime sur le plan stratégique.
Un dialogue structuré : la seule issue réaliste pour GAC
On peut penser à raison que la porte du dialogue n’est pas fermée. Si GAC ou EGA décidait de revenir à la table avec une proposition solide, ondée sur un plan industriel concret, un calendrier contraignant et réaliste, et un dispositif indépendant de suivi des engagements, alors la Guinée pourrait envisager une reprise des discussions.
Mais cette reprise ne saurait s’inscrire dans la continuité des pratiques passées. Elle suppose un nouveau cadre, plus exigeant, plus transparent, et résolument tourné vers des résultats vérifiables. L’ère des promesses vagues ou indéfiniment reportées est désormais close. GAC ne pourra espérer restaurer la confiance qu’en démontrant, par des actes, sa volonté réelle de respecter l’esprit comme la lettre du contrat.
Une posture en cohérence avec la doctrine du Quasi-Monopole Naturel
La fermeté de l’État guinéen s’inscrit pleinement dans l’architecture idéologique de ce que j’appelle la doctrine du Quasi-Monopole Naturel (QMN). Lorsqu’un pays, comme la Guinée avec la bauxite, détient une part prépondérante d’une ressource stratégique, plus des deux tiers des réserves mondiales connues, à haute teneur et facilement exploitables, il ne s’agit pas d’un simple avantage. C’est une position dominante, presque unique, qui confère à l’État une capacité exceptionnelle de fixer les règles du jeu, de négocier avec assurance et de conditionner l’accès à ses ressources à des engagements clairs en matière de transformation locale.
Cette posture, loin d’être agressive, est une affirmation rationnelle d’un droit souverain. Elle suppose une stratégie calme mais résolue, orientée vers un objectif fondamental, en occurrence, celui de bâtir une industrie nationale forte, véritable moteur du développement économique et de l’autonomie structurelle. C’est dans ce cadre qu’il faut comprendre les mots emblématiques du Général Amara Camara : « Ce que nous voulons désormais, c’est assumer notre souveraineté minière »
il s’agit d’une volonté de ne plus subir les logiques d’extraction sans valeur ajoutée, mais de reprendre la main sur les conditions d’exploitation de nos ressources, dans l’intérêt de la Guinée et des Guinéens.