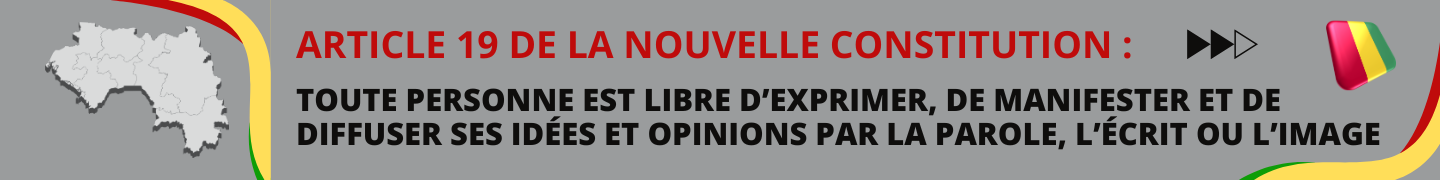Les astres de la prévision politique semblent s’aligner en Guinée en faveur des autorités de transition, même si, à ce jour, aucun parti politique n’a officiellement présenté le chef de la transition comme porte-flambeau pour les prochaines élections présidentielles. Les partis traditionnels qui ont marqué la scène politique guinéenne au cours de la dernière décennie affichent désormais une visibilité et une influence réduites auprès de leurs militants et de l’électorat. Les manifestations de rue, souvent énergiques et parfois violentes, tout comme les appels mobilisateurs au ton belliqueux exigeant un retour rapide à l’ordre constitutionnel, ont disparu, faute d’actions concrètes sur le terrain. Le RPG/Arc-en-ciel, l’UFDG, l’UFR et d’autres groupes de pression ne sont aujourd’hui plus que l’ombre d’eux-mêmes. Les figures emblématiques de ces mouvements se retrouvent pour la plupart en exil, volontairement ou non.
Comment expliquer la déliquescence de ces partis politiques ? De nombreux analystes et chroniqueurs politiques avaient déjà alerté les militants sur les modes de fonctionnement opaques et les pratiques antidémocratiques internes, susceptibles de conduire à leur perte.
Au cours des deux dernières décennies, les partis guinéens se sont souvent comportés comme des entreprises privées défaillantes, dirigées d’une main de fer par un chef ou président qui cumulait les rôles de décideur, bailleur de fonds et stratège, agissant selon ses humeurs et les rumeurs qui lui convenaient. Dans ces conditions, un parti cesse d’être une organisation politique au sens noble, car il ne respecte plus les normes de gouvernance : application effective des statuts, gestion transparente, organisation régulière de congrès pour débattre et résoudre les problèmes internes, etc. Ces activités, essentielles à la santé démocratique et à la pérennité d’un parti, ont fait défaut aux formations traditionnelles guinéennes.
Le manque de collégialité dans la prise de décision, la gestion financière centralisée et opaque, l’exploitation de l’appartenance ethnique à des fins de maintien du pouvoir et de capitalisation électorale sont autant de caractéristiques qui ont fragilisé les partis. Il est important de rappeler qu’un parti politique n’est pas une propriété privée. Ces travers historiques expliquent le déclin actuel de leur influence sur la scène politique nationale.
Comme le dit l’adage : « La nature a horreur du vide ». L’interdiction prolongée des activités politiques par les autorités de transition et la fermeture de certains sièges ont créé un vide aussitôt investi par le pouvoir en place, à travers les mouvements de soutien qui relaient son message et renforcent son ancrage dans la population. Cette stratégie s’est accompagnée de la réalisation de projets visibles et concrets, là où les citoyens, habitués aux promesses sans lendemain, peuvent constater qu’avec un brin de patriotisme, il est possible d’agir pour le bien commun en peu de temps. Beaucoup de ces projets avaient été initiés sous l’ancien régime, mais leur réalisation avait été compromise par le manque d’engagement collectif et la priorité donnée aux intérêts privés.
Les démissions successives enregistrées au sein des vieux partis n’augurent rien de bon pour leur avenir. Tout porte à croire que les partis traditionnels guinéens ont perdu leur éclat, laissant le champ libre aux autorités de la transition, qui bénéficient d’un soutien croissant d’une population déçue par les régimes précédents. Pour parachever cette dynamique, les autorités de transition envisageraient de réexaminer la situation des médias traditionnels, aujourd’hui interdits, dans la perspective d’une éventuelle réouverture, ce qui leur permettrait de renforcer encore leur acceptabilité sociale et, in fine, de sonner le glas des partis politiques traditionnels.
Fodeba Dioubaté, enseignant-journaliste au Canada